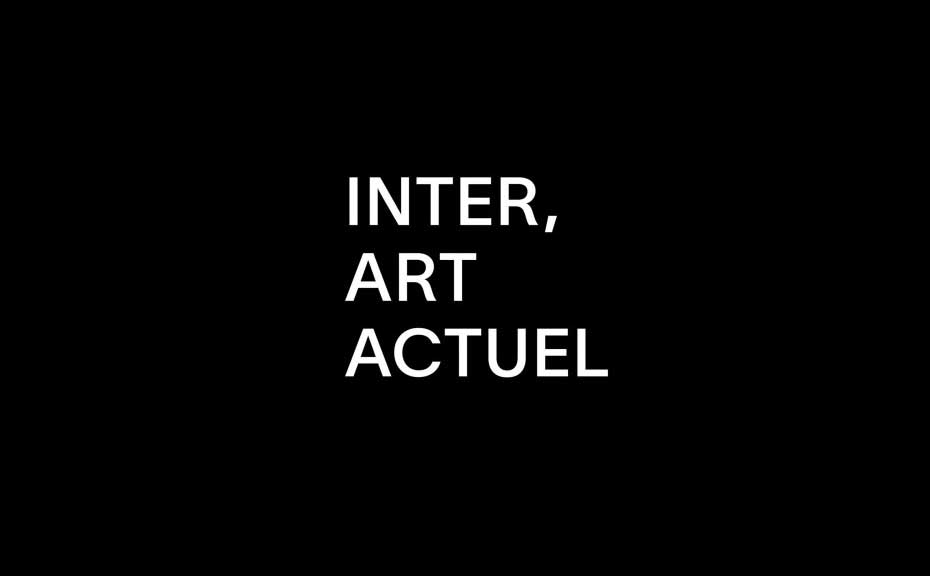
Appel aux textes et aux visuels – Inter, art actuel n° 147 : « Ouïr »
- Date limite : 30 octobre 2025
- Catégorie: Appels de dossiers
- Ville: Québec
Performances et installations sonores
- Date limite d’envoi : 30 octobre 2025
- Publication : Printemps 2026
- Soumissions : redaction@inter-lelieu.org
- Détails : inter-lelieu.org
Formats :
- Textes : Maximum 3 500 mots
- Visuels : JPEG ou TIFF, 300 dpi, minimum 46 x 30 cm
Responsables du dossier :
- Érick D’Orion
- Catherine Lalonde-Massecar
- Alexandre St-Onge
Inter, art actuel lance un appel à contributions pour son numéro 147, à paraître au printemps 2026. Ce dossier thématique, intitulé « Ouïr », propose d’explorer les interrelations entre création sonore, performativité et installation dans les pratiques en arts actuels. Nous invitons les artistes, auteur·trice·s, chercheur·euse·s, commissaires et travailleur·euse·s culturel·le·s à soumettre des textes critiques, essais, analyses d’œuvres, récits d’expériences, entrevues ou propositions visuelles s’inscrivant dans cette réflexion.
Axes du dossier :
1. Performativité et production sonore
Ce premier axe examine les tactiques employées, les objets utilisés et les interfaces élaborées par les artistes pour établir des liens de réciprocité entre les actions performatives et la production sonore. Il s’agira d’analyser les dispositifs favorisant des boucles de rétroaction entre toutes les entités en jeu : corps, sons, gestes, environnements.
2. Dispositifs et écritures de l’écoute
Ce second axe s’intéresse à la mise en place de dispositifs, à leurs formes d’écriture et de scénographie. Il vise à explorer les registres d’expérimentation et d’interaction entre l’artiste, le son et le public, tout en interrogeant les dimensions techniques et esthétiques de l’émission et de la transmission.
3. Le son dans l’espace public et l’interdisciplinarité
Le troisième axe portera sur les formes installatives dans l’espace public, où le son croise sculpture, vidéo, musique, performance, théâtre, arts visuels et littérature. Ces croisements deviennent des vecteurs de spatialisation, de résonance et d’écoute étendue – visuelle, haptique, auditive ou psychique.
Le son, ainsi diffusé, excède toute tentative de localisation stable. Il se dissémine, circule sans centre, sans origine fixe, dans un espace devenu surface d’inscription mouvante. Le repérage auditif y est mis en crise : l’auditeur ne peut plus situer la source, car le son déjoue les repères spatio-temporels traditionnels, au profit d’une spatialisation délinéarisée. L’expérience d’écoute devient alors un lieu de glissement, de déplacement continu, où l’identité du son – tout comme celle du sujet percevant – se déconstruit dans l’instant même de sa perception.
Ce brouillage des frontières entre les disciplines, les sens, les lieux d’émission et de réception, opère une abstraction du sonore : il n’est plus objet, mais différence en acte. L’installation sonore devient ainsi un champ de forces, un jeu de traces et de résonances.